 |
Le plancher de Jean - [?]
Jean - dit : Jeannot le Béarnais, 1971
|
Le plancher de Jean est un texte de 80 lignes de lettres capitales poinçonnées, gravé en creux sur quatre grandes pièces de plancher en bois de chêne - d'une surface de 16 m2, au total.
Histoire muséale
Le Plancher de Jean est découvert dans la maison familiale de son auteur, plus de 20 ans après la mort de ce dernier, en 1993 au moment du décès de Paule, sa soeur. Le Dr Roux (psychiatre retraité), qui y voit une "psychose brute", en fait l’acquisition via le marché des antiquaires.
C'est dans le catalogue « L’Aracine et l’Art brut » en 1999 qu'il est question, pour la premier fois, de ce plancher en tant qu'œuvre d'art brut. Trois ans plus tard, le Dr Roux le vend au laboratoire pharmaceutique Bistrol-Myers-Squibb. Le Plancher est alors installé dans le hall du siège social de l'entreprise, à Rueil Malmaison.
Mais il circule : il est exposé en 2004, à la Collection de l'Art Brut de Lausanne et à la Halle Saint Pierre à Paris, à l'occasion de l'exposition
Ecriture en délire puis en octobre 2005 à la Bibliothèque nationale de France. Il est ensuite cédé au Centre hospitalier Sainte-Anne (Paris) suite à l’insistance du professeur Jean-Pierre Olié (PH-PU en psychiatrie, chef de service hospitalo-universitaire). Depuis le 2 juillet 2007, le Plancher de Jean est exposé sous verre,
sur le trottoir de la rue Cabanis (14ème arrondissement) qui longe l'hôpital de Saint-Anne.
Réception artistique
2005 :
Une pièce de Théatre contemporain (texte de Pascale Rebetez, mise en scène de Philippe Sireuil) est donnée pour la première fois au théatre en Vieille Ville de Genève, en 2005, sous le titre
Les mots de savent pas dire
2007 :
La Maison Européenne de la Photographie a accueilli une
exposition de photographies du Plancher de Jean par l'artiste photographe Martin d'Orgeval. Il s'agit d'une série de photographies en noir et blanc. Le point de vue rapproché et le travail du contraste en restitue la matérialité tactile.
2013 :
La poétesse, romancière et recherchiste indépendante Perrine le Querrec publie un ouvrage chez "Les doigts dans la prose", intitulé Le plancher.
L'artiste pluridisciplinaire Sebastian Rivas compose un monodrame intitulé "Le Plancher de Jeannot", à la Maison des arts de Créteil.
2015 :
Ingrid Thobois, publie un court roman intitulé Le plancher de Jeannot, dans lequel elle confie l'instance narrative à Paule, la sœur de Jean, pour raconter leur histoire.
Biographie de Jean
Jean est né en 1939 au sein d'une famille de fermiers, dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques). Alors qu'il effectue son service militaire en Algérie, son père se pend. Ce drame entraine une dégradation de la situation socio-économique de sa famille. La mère de Jean meurt en 1971. Avec la complicité de sa sœur Paule, Jean l'enterre sous l'escalier de la maison et grave son texte sur le Plancher qui la recouvre. Il meurt d'inanition, quelques semaines plus tard.
La biographie de Jean a pu être étoffée conjointement à la divulgation de son œuvre, à partir de sources hétérogènes. Disons rapidement que l'hypothèse d'une psychose semble faire l'unanimité pour les médecins, les témoins de l'histoire de la famille et les auteurs qui se son penchés sur son œuvre, et que les premiers "troubles du comportement" de Jean se seraient fait sentir (d'après le voisinage) dans les années 1960, après le suicide de son père et tandis que la famille s'appauvrissait. Mais sa trajectoire psychologique reste, finalement, incertaine : Jean n'a jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique de son vivant.
Situer le Plancher
Au regard de ces éléments biographiques, l'histoire institutionnelle et marchande du Plancher de Jean ainsi que les modalités actuelles de sa conservation et de son expositionfont débat. Que le Plancher ait été acheté en tant que témoignage d'une "psychose brute" (non soignée, non traitée...), par un laboratoire pharmaceutique qui commercialise des médicaments anti-psychotiques, a de quoi laisser craindre une instrumentalisation publicitaire. C'est aussi la compréhension réductrice de l'œuvre, sous-jacente à cette opération publicitaire, qui poserait problème : le Plancher de Jean serait censé alarmer le visiteur du siège social de Bistrol-Myers-Squibb en raison de la folie dont il serait le signe ostentatoire.
Aujourd'hui, la mise en scène du Plancher continue de poser question. Il y a que son exposition à ciel ouvert, à proximité de l'hôpital Sainte-Anne, en trois pans verticaux séparés, et sous verre, répond à des impératifs extérieurs à l'œuvre elle-même (Jean a gravé ces mots sur le sol et sous un toit), et qu'on ne saurait départir ce qui, parmi ce qui a orienté ces choix de présentation, relève de la conservation préventive, de la contrainte d'espace et de la visée spectaculaire... D'après le docteur Olié, il s'agirait cette fois de combattre la honte et les préjugés qui pèsent sur les maladies mentales mais cet usage du Plancher ne le détache toujours pas de la folie qu'il serait censé représenter - serait-ce, désormais, d'une façon inhabituelle plutôt qu'effrayante.
Enfin : l'hôpital de Sainte-Anne conserve par ailleurs une collection d'œuvres graphiques et picturales dédiée à l'étude clinique, dont la plupart lui avaient été données à l’issue de l’Exposition internationale d’art psychopathologique de 1950. Cette collection a reçu, en mars 2016, l’appellation « Musée de France ». Le site d’exposition, s’appelle désormais MAHHSA (Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne), et a récemment intégré Videomusem (réseau de collections d’art moderne et contemporain). Mais le Plancher de Jean n'est pas (pas encore ?) présenté au sein de la galerie virtuelle du MAHHSA, et ne figure pas (pas encore ?) sur la base Navigart (qui réunit toutes les collections du réseau Videomuseum).
Voilà donc un objet que l'on tarde, que l'on peine à situer, que ce soit en termes de statut (indexation au sein d'une collection muséale) comme en termes d'exposition (lieu, socle, choix scénographiques...). Les raisons à cela peuvent être administratives et techniques : les dimensions et les particularités matérielles du Plancher rendent son traitement complexe. Mais cet état d'indécision est aussi symbolique : le Plancher est toujours en suspens entre différentes réceptions, différentes approches, différents usages (commerciaux, médicaux, artistiques....). Il faut bien, pour qu'une œuvre ait lieu, matériellement et symboliquement, se poser la question du prisme à travers lequel la regarder ou la lire - sachant que résoudre ce problème ne consiste pas seulement, ne consiste même pas nécessairement à choisir parmi une liste restreinte de modalités de lectures pré-établies.
- Ecouter :
- Lire :
LA RELIGION A INVENTE DES MACHINES A COMMANDER LE CERVEAU DES GENS ET BETES ET AVEC UNE INVENTION A VOIR NOTRE VUE A PARTIR DE RETINE DE L’IMAGE DE L’ŒIL ABUSE DE NOUS SANTE IDEES DE LA FAMILLE MATERIEL BIENS PENDANT SOMMEIL NOUS FONT TOUTES CRAPULERIE L’EGLISE APRES AVOIR FAIT TUER LES JUIFS A HITLER A VOULU INVENTER UN PROCES TYPE ET DIABLE AFIN PRENDRE LE POUVOIR DU MONDE ET IMPOSER LA PAIX AUX GUERRES L’EGLISE A FAIT LES CRIMES ET ABUSANT DE NOUS PAR ELECTRONIQUE NOUS FAISANT CROIRE DES HISTOIRES ET PAR CE TRUQUAGE ABUSER DE NOS IDEES INNOCENTES RELIGION A PU NOUS FAIRE ACCUSER EN TRUQUANT POSTES ECOUTE OU ECRIT ET INVENTER TOUTES CHOSES QU’ILS ONT VOULU ET DEPUIS 10 ANS EN ABUSANT DE NOUS PAR LEUR INVENTION A COMMANDE CERVEAU ET A VOIR NOTRE VUE A PARTIR IMAGE RETINE DE L’ŒIL NOUS FAIRE ACCUSER DE CE QU’IL NOUS FON A NOTRE INSU C’EST LA RELIGION QUI A FAIT TOUS LES CRIMES ET DEGATS ET CRAPULERIE NOUS EN A INVENTE UN PROGRAMME INCONNU ET PAR MACHINE A COMMANDER CERVEAU ET VOIR NOTRE VUE IMAGE RETINE ŒIL NOUS E FAIRE ACCUSER … NOUS TOUS SOMMES INNOCENT DE TOUT CRIME… TORT A AUTRUI NOUS JEAN PAULE SOMMES INNOCENTS NOUS N AVONS NI TUE NI DETRUIT NI PORTE DU TORT A AUTRUI C EST LA RELIGION QUI A INVENTE UN PROCES AVEC DES MACHINES ELECTRONIQUES A COMMANDER LE CERVEAU SOMMEIL PENSEES MALADIES BETES TRAVAIL TOUTES FONCTIONS DU CERVEAU NOUS FAIT ACCUSER DE CRIMES QUE NOUS NAVONS PAS COMMIS LA PREUVE LES PAPES S APPELLENT JEAN XXIII AU LIEU DE XXIV POUR MOI PAUL VI POUR PAULE L’EGLISE A VOULU INVENTER UN PROCES ET COUVRIR LES MAQUIS DES VOISINS AV MACHINES A COMMANDER LE CERVEAU DU MONDE ET A VOIR LA VUE IMAGE DE L ŒIL FAIT TUER LES JUIF A HITLER ONT INVENTE CRIMES DE NOTRE PROCES
N.B. : Par la référence aux technologies de pointe de la fin des années 1960, ce texte est le signe d'une relation à un contexte et non pas seulement d'un état mental à appréhender isolément. Ce qui me frappe en premier lieu c'est que cette thématique est a priori très éloignée de l'image du paysan Béarnais muré dans sa ferme : poste écoute, programme, image rétine de l'œil machines électroniques à commander le cerveau. Je me demande par quel biais Jean a pu avoir accès aux accessoires de ce décorum : techniques d'espionnage, recherches en optique, en informatique et en électronique. Le seul élément de sa biographie officielle susceptible de nous éclairer serait son séjour (écourté) en Algérie, à l'occasion duquel il a certainement été en contact avec des technologies militaires apparentées... mais son portrait est brossé d'une façon qui met plutôt l'accent sur son attachement à la terre familiale, sur son isolement, sa claustration ; il ne permet pas d'envisager qu'il ait pu entretenir cette sensibilité à l'univers de la cybernétique ni comment il l'aurait fait. Disons que Jean avait peut-être un poste de radio mais je serais surprise d'apprendre qu'il avait un téléviseur : en France, en 1970, un seul foyer sur dix était équipé. On peut toujours imaginer qu'il avait feuilleté des magazines, cette année-là... Mais on ne peut pas le vérifier.
 |
Science&Vie
n° 637 (octobre 1970) et n°639 (décembre 1970) |
BIBLIOGRAPHIE
Madeleine Lommel (dir.), L’Aracine et l’Art brut, Z'Editions, 1999
Dr Guy Roux, Histoire du plancher de Jeannot. Drame de la terre ou puzzle de la tragédie, Photographies de Françoise Stijepovic, Préface d’Alain Bouillet, Ed. Encre et lumière, 2005
Animula Vagula [blog],
notes sur le Plancher de Jeannot - 2006-2012
Martin d'Orgeval, Réquisitoire : "Le plancher de Jean" [exposition, Maison européenne de la photographie, 10 octobre 2007-6 janvier 2008], texte de Jean-Pierre Olié, 2007
Céline Delavaux, "Chronique d'une capture" in : Cassandre N° 71, 2007, p. 78-79
Perrine Le Querrec, Le Plancher, Ed. Les doigts dans la prose, mars 2013
Ingrid Thobois, Le plancher de Jeannot, Ed. Buchet Chastel, collection Qui Vive, mars 2015


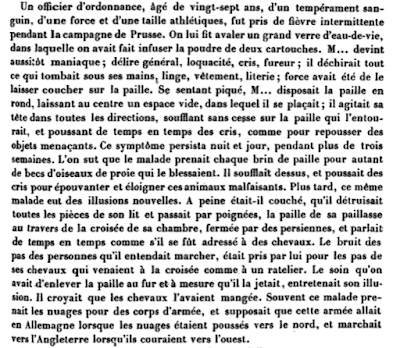





 2.
2. 













